
J’imagine d’ailleurs parfois que tous les livres, quels que soient leur genre et leur qualité, forment une unique et vaste étendue textuelle, qu’ils sont tous contigus. Ce grand paysage de prose ressemble à La Prairie, le dernier roman du cycle de Fenimore Cooper. Comme le Chasseur de daim, je me tiens débout, appuyé sur ma longue carabine, vieillissant et solitaire guetteur de l’immense plaine du texte.
S’agit-il du tout premier, Le Club des cinq et le Trésor de l’île ? Tous appartiennent à ces productions populaires dont le ressort semble être le retour de l’identique, le plaisir régressif de lire toujours la même histoire, comme les romans sentimentaux des éditions Harlequin que dévorait ma tante Françoise, dont l’héroïne finissait toujours dans le lit de l’homme riche qui lui avait paru méprisant et inaccessible. Il y a dans ce ressassement quelque chose de vertigineux.
Les épisodes du Club des cinq, Famous Five en anglais, prétendent avoir un auteur, Enid Blyton, prénom et nom tout à fait indéchiffrables pour moi à l’époque. Je pensais que c’était un homme, alors que c’est une femme ; je le croyais français, égaré par ce texte qui était davantage une adaptation qu’une traduction, alors qu’elle est anglaise… La Cornouaille britannique y était transformée en Bretagne française, si mes souvenirs ne me trompent pas. Mais croyais-je réellement à l’existence d’Enid Blyton ? L’auteur d’un texte n’est-il pas aussi fictif que les histoires qu’il trame ? D’ailleurs sa traductrice française, Claude Voilier, a écrit un certain nombre de titres sous ce nom. Ne me reste de cette lecture que la figure de la fille qui est présentée comme un garçon manqué. Son prénom dans la version française est ambigu, Claude (tiens, celui de la traductrice), comme Enid l’était pour moi à l’époque. Entêtée, un peu colérique, parfois boudeuse, Claude est le seul personnage intéressant, et j’éprouvais peu d’intérêt pour ses compagnons ou pour le chien, Dagobert. Ce premier roman que je lus en entier me donna un léger mal de tête, pendant le silence d’un après-midi d’été à Quimiac (Loire atlantique), alors que j’étais caché au « garage » qui n’était plus un garage, mais qui abritait tout de même pendant la mauvaise saison le bateau de mon grand-père Jean, une barque à mât baptisée « l’Arche de Noé » dont le nom assimilait plaisamment ses enfants et ses petits-enfants à des animaux.
J’en éprouvais du vertige et de l’exaltation, la sensation d’avoir passé une frontière, ouvert un espace passionnant et solitaire. Les procédés d’accroche de la parole rapportée paraissaient délicieusement littéraires à mon ignorance, je n’avais jamais entendu personne parler ainsi : « répliqua-t-il », « cria-t-il », « chuchota-t-elle ». Je crois que nous en fîmes un jeu avec mon frère Christophe, dès qu’il fut en âge de lire lui aussi.
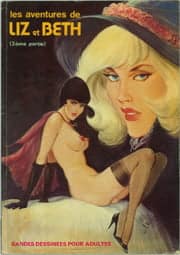
Une vie dans les livres

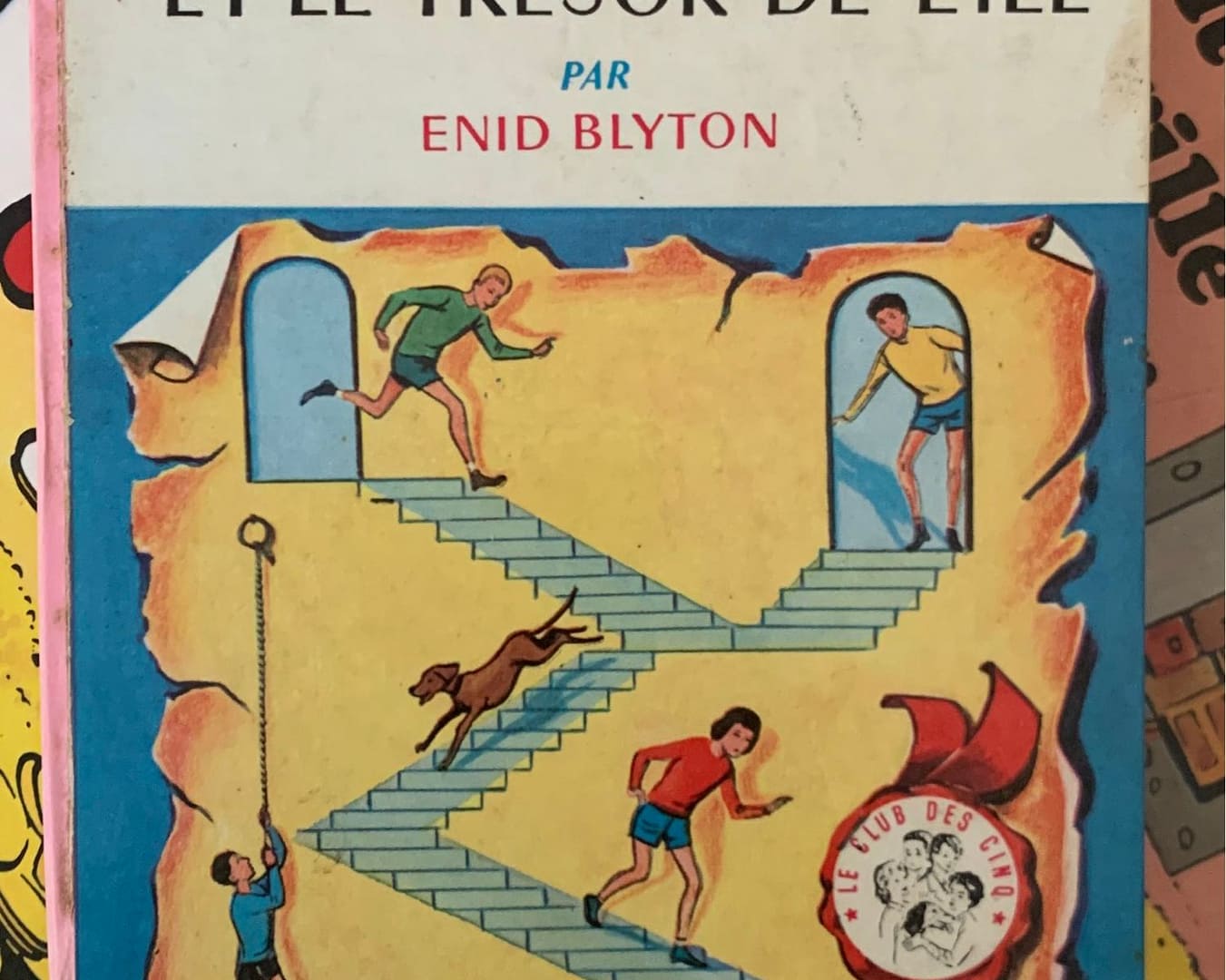
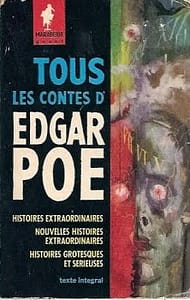
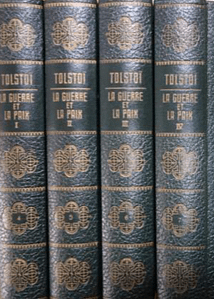 Je ne sais plus si j’avais dix ou onze ans, si c’était avant ou après Les Misérables. Ce fut le début d’une prédilection pour le roman russe et pour l’époque napoléonienne. La lecture a encore comme cadre l’été, quinze jours ou un mois, avec Tolstoï. Le saisissement a oblitéré l’endroit où je passais mes vacances. La neige et le champ de bataille de Borodino, avec davantage de figurants que le cinéma n’a jamais pu en payer, les salons avec leurs chandelles, contrastent en tout cas avec la lumière et la chaleur du mois de juillet ou d’août.
Je ne sais plus si j’avais dix ou onze ans, si c’était avant ou après Les Misérables. Ce fut le début d’une prédilection pour le roman russe et pour l’époque napoléonienne. La lecture a encore comme cadre l’été, quinze jours ou un mois, avec Tolstoï. Le saisissement a oblitéré l’endroit où je passais mes vacances. La neige et le champ de bataille de Borodino, avec davantage de figurants que le cinéma n’a jamais pu en payer, les salons avec leurs chandelles, contrastent en tout cas avec la lumière et la chaleur du mois de juillet ou d’août.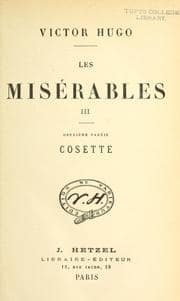
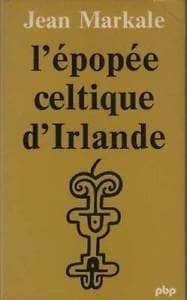
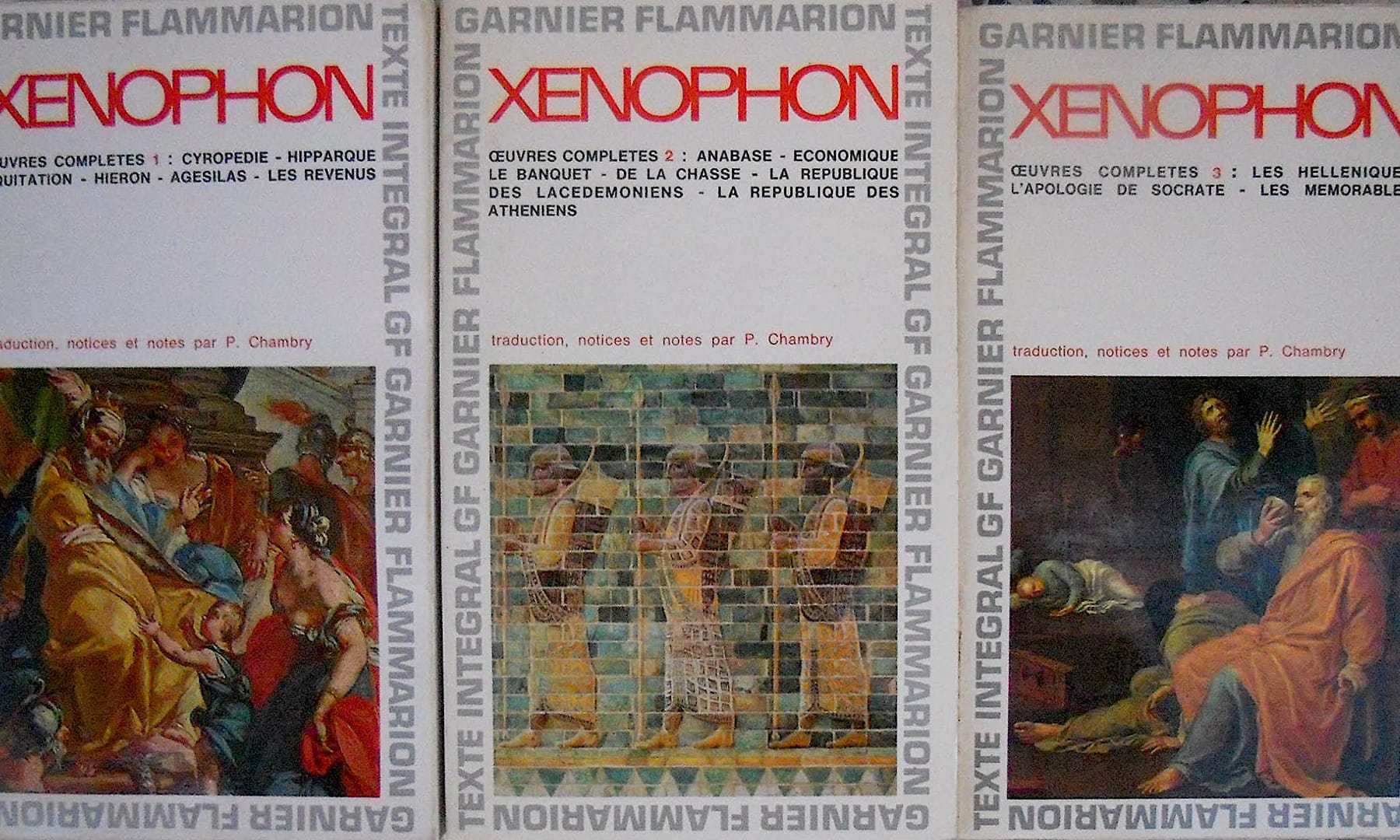
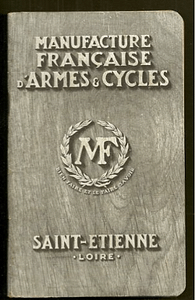 La maison délicieusement vieillotte et inconfortable de nos arrière-grands-parents à Solesmes possédait un jardin en pente, planté de pommiers à cidre et de magnifiques bouquets de rhubarbe et d’oseille, qui aboutissait à la Sarthe, derrière une barrière soigneusement fermée. Si elle regorgeait de bibelots et de souvenirs étonnants, la maison n’était pas très riche en romans, pour autant que je me souvienne, mais recélait, pour qui savait fouiller et n’avait pas peur de la poussière, quelques authentiques trésors. D’abord une collection de Lecture pour tous d’avant-guerre, dont j’embrassais sans difficulté les reportages d’actualité, les petits romans et même les principes anachroniques. Tout jeune déjà, je me mouvais dans le passé comme si j’étais chez moi. Sans me gêner, je détaillai la manière dont les dames étaient habillées, je m’asseyais à la table des banquets, je mettais les pieds dans le plat. Je n’avais pas encore lu La Machine à remonter le temps de H. G. Wells, mais l’idée du voyage dans le temps ne m’aurait pas du tout étonné.
La maison délicieusement vieillotte et inconfortable de nos arrière-grands-parents à Solesmes possédait un jardin en pente, planté de pommiers à cidre et de magnifiques bouquets de rhubarbe et d’oseille, qui aboutissait à la Sarthe, derrière une barrière soigneusement fermée. Si elle regorgeait de bibelots et de souvenirs étonnants, la maison n’était pas très riche en romans, pour autant que je me souvienne, mais recélait, pour qui savait fouiller et n’avait pas peur de la poussière, quelques authentiques trésors. D’abord une collection de Lecture pour tous d’avant-guerre, dont j’embrassais sans difficulté les reportages d’actualité, les petits romans et même les principes anachroniques. Tout jeune déjà, je me mouvais dans le passé comme si j’étais chez moi. Sans me gêner, je détaillai la manière dont les dames étaient habillées, je m’asseyais à la table des banquets, je mettais les pieds dans le plat. Je n’avais pas encore lu La Machine à remonter le temps de H. G. Wells, mais l’idée du voyage dans le temps ne m’aurait pas du tout étonné. 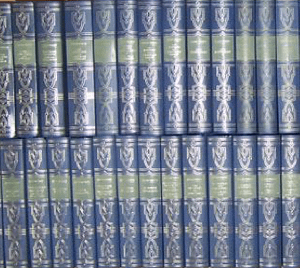 Je parle des œuvres complètes, de l’intégrale en format poche, avec les gravures d’origine, dans une édition plastifiée à laquelle avait participé Michel Roethel libraire spécialisé de la rue Lagrange que je finirais par rencontrer. Ses vitrines contenaient les somptueuses éditions originales des « Voyages fantastiques » de Jules Hetzel et cent autres trésors qui m’arrêtaient longuement alors que je descendais de la montagne Sainte-Geneviève, en revenant du collège. Tout cela déboule dans mon imagination déjà fiévreuse, le héros sous-marin, sombre, rebelle, qui s’appelle « personne », comme Ulysse, le flegme britannique qui me paraissait un idéal moral aussi élevé que le stoïcisme, l’astuce du Français Passepartout, une princesse indienne enlevée aux cruels sectateurs de Kali, un voyage dans la lune à bord d’un obus, un éléphant à vapeur, un héritage disputé lors d’un jeu de l’oie à la taille la carte des États-Unis, des diamants artificiels, une ville flottante, des Carpates ténébreuses, des robinsonnades en famille, les chevauchées furieuses de Michel Strogoff, ses yeux épargnés par la lame chauffée à rouge à cause des larmes versées sur le sort de sa mère. Et naturellement, j’en sauvais, des princesses ! Et les tourments dont je les délivrais étaient imaginés avec un sadisme raffiné.
Je parle des œuvres complètes, de l’intégrale en format poche, avec les gravures d’origine, dans une édition plastifiée à laquelle avait participé Michel Roethel libraire spécialisé de la rue Lagrange que je finirais par rencontrer. Ses vitrines contenaient les somptueuses éditions originales des « Voyages fantastiques » de Jules Hetzel et cent autres trésors qui m’arrêtaient longuement alors que je descendais de la montagne Sainte-Geneviève, en revenant du collège. Tout cela déboule dans mon imagination déjà fiévreuse, le héros sous-marin, sombre, rebelle, qui s’appelle « personne », comme Ulysse, le flegme britannique qui me paraissait un idéal moral aussi élevé que le stoïcisme, l’astuce du Français Passepartout, une princesse indienne enlevée aux cruels sectateurs de Kali, un voyage dans la lune à bord d’un obus, un éléphant à vapeur, un héritage disputé lors d’un jeu de l’oie à la taille la carte des États-Unis, des diamants artificiels, une ville flottante, des Carpates ténébreuses, des robinsonnades en famille, les chevauchées furieuses de Michel Strogoff, ses yeux épargnés par la lame chauffée à rouge à cause des larmes versées sur le sort de sa mère. Et naturellement, j’en sauvais, des princesses ! Et les tourments dont je les délivrais étaient imaginés avec un sadisme raffiné.